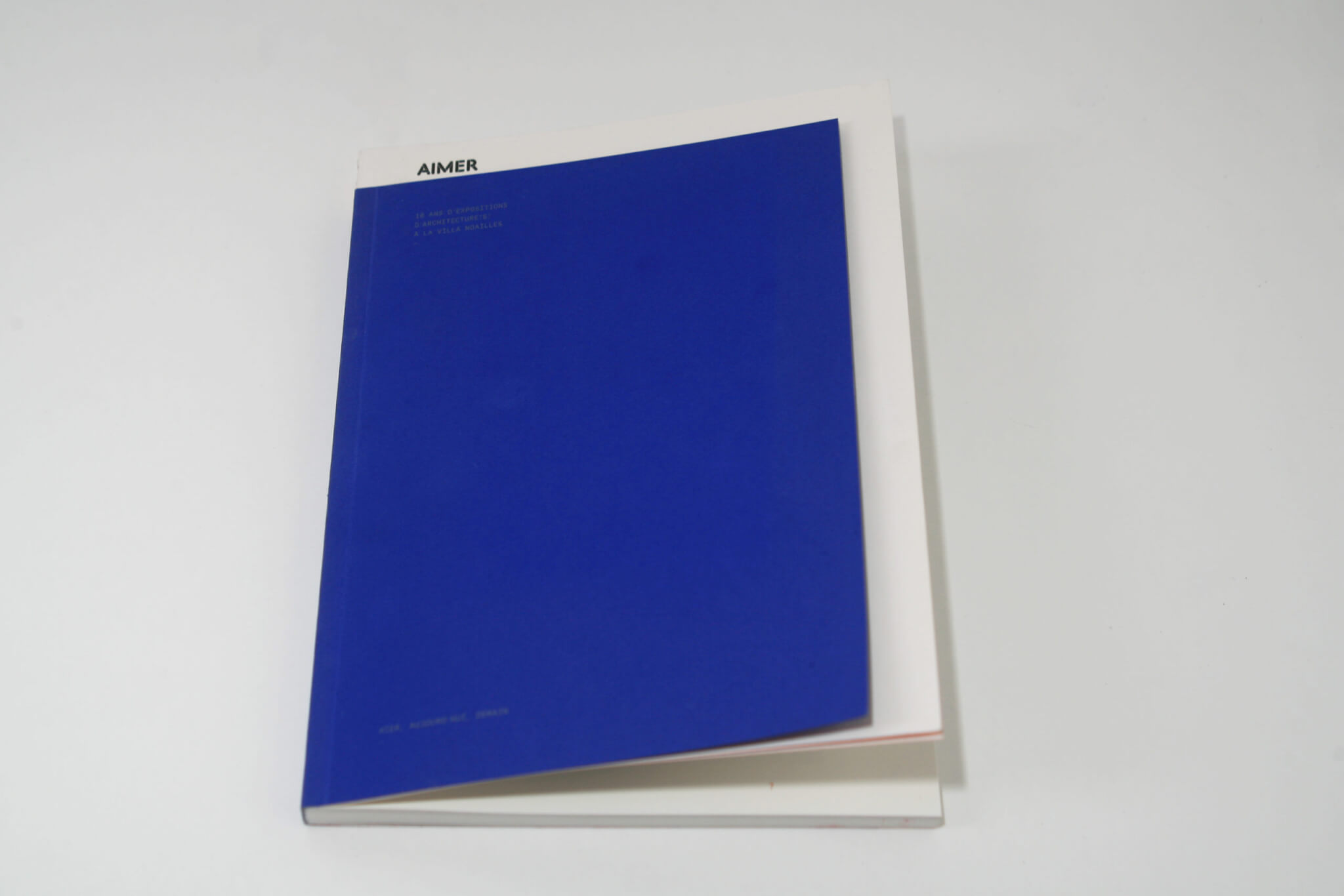Anna Heringer et Tyin tegnestue
Quand la stratégie du soutenable est – bien au delà de « l’exercice architectural » – un véritable enjeux, la maîtrise de l’esthétique est l’échelle d’évaluation de la réponse apportée.
Florence Sarano
OUVRAGE / AUTEUR 2007
CONSTRUIRE AILLEURS, AUTREMENT, ENSEMBLE.
Partir construire ailleurs. Là-bas le terme abri reprend tout son sens premier. L’architecte peut jouer un rôle social, culturel et économique engagé. Construire c’est s’attaquer à trouver des solutions pour une population dont les besoins élémentaires de survie sont si fragilisés. Les enjeux architecturaux nécessitent d’aller au-delà de notre quotidien confortable.
Là-bas l’autonomie c’est avoir accès au minimum vital (se laver, s’abriter, apprendre, se soigner, se réunir aussi…). C’est pouvoir ainsi rester dans son village, dans sa communauté, grâce à une école, des bains publics et une maison communautaire, un orphelinat… autant de programmes qui permettent de maintenir et faire vivre les identités locales face au développement global uniformisé et anonyme.
Ici, durant leurs études, ce sont des jeunes gens qui se sont engagés pour partir étudiants et en revenir architectes. Créant, comme TYIN, une organisation humanitaire afin de récolter de l’argent auprès d’architectes de leur pays d’origine, la Norvège.
Parce que là-bas les enjeux sont plus urgents, plus extrêmes, mais aussi plus culturels, plus identitaires, finalement ils nous renvoient à une re-lecture de nos propres enjeux.
Penser à construire autrement. Quand les pluies des moussons entraînent des maladies, et que la chaleur écrasante interrompt toute activité, il faut gérer l’écoulement de l’eau, la circulation de l’air, la création de l’ombre, la distance avec le sol, les coopérations avec la végétation.
Les climats extrêmes rendent la vie plus difficile aux populations pauvres, et répondre « autrement » c’est jouer avec ces éléments pour en faire de l’architecture et non du temporaire. Pour que cet « autrement » soit avant tout humain, il doit être appropriable par chacun. Oublier la machinerie de l’air conditionné, les toitures en tôles brûlantes, les matériaux polluants : il faut gérer les forces naturelles des éléments et parfois les associer aux technologies qui fourniront l’autonomie énergétique.
Face aux matériaux nouveaux mais coûteux, il y a aussi d’anciennes techniques constructives mais souvent oubliées : alors concevoir autrement c’est utiliser ces traditions en les réinterprétant avec des organisations spatiales adaptées à l’évolution de la vie. Construire autrement, sans dépendre de matériaux importés, c’est rendre accessible financièrement les moyens de construire l’abri pour sa famille. Décliner ces matériaux ancestraux c’est réactualiser les savoir-faire locaux, c’est recréer une économie in situ. C’est peut-être redonner une identité propre à chaque région en reliant coutumes et vie moderne : c’est permettre l’altérité.
Penser autrement pour offrir et conserver un meilleur environnement, sans pollution causée par certaines énergies et objets manufacturés. Recycler, réutiliser, combiner, décliner, détourner, associer matériaux naturels et matériaux existant sur place, c’est générer une économie autre, une économie soutenable pour ces populations et leur milieu naturel.
Là-bas, imaginer autrement c’est aussi créer une esthétique différente : celle de la sensualité de la terre rouge, de l’ombre des bambous, de la courbe du pneu coupé en deux et qui devient gouttière, de l’empreinte des mains qui ont construit généreusement ce mur si charnel.
Vouloir construire ensemble. Ensemble autour des étudiants, se retrouvent les habitants : les enfants, les femmes, les ouvriers, les paysans, les soldats parfois et d’autres étudiants architectes locaux et ces indispensables organisations humanitaires.
Les premières rencontres pour définir les besoins prioritaires, ainsi que les modes d’édification, le transport des matériaux, l’assemblage des poutres, la construction des échafaudages, le coulage en place des fondations, le tressage des ombrières. Ensemble, bâtir une énergie commune qui dépasse ce que les langages séparent : vouloir construire l’espace de l’altérité.
Puis vient le temps de jouer, de partager l’espace de la salle de classe, de danser, et de partir… en laissant la possibilité de poursuivre l’aventure humaine des « savoir-faire ensemble » mis en place et des nouvelles identités où chacun trouve son espace, peut-être celui de ce mur dans lequel on peut venir lire ou de cette paroi de bambou derrière laquelle on peut se laver en regardant la forêt thaïlandaise sous la mousson.
OUVRAGE EXTRAIT / ARTICLE 1
AUTEUR
Florence Sarano
Achibooks + Sautereau éditeur
2007

POUR UNE STRATÉGIE SOUTENABLE: DE L’ÉTHIQUE À L’ESTHÉTIQUE
parce que le problème est la solution
Se relier plutôt que se séparer. Pourquoi relier les habitants, les communautés, les femmes, les artisans et les enfants à la fabrication de l’édifice depuis sa conception jusqu’à sa réalisation ? Parce que c’est l’empreinte des mains de chacun que l’on retrouvera sur les murs à chaque regard porté sur leur surface, parce que c’est l’habileté du lien noué par lui et elle qui retiendra chaque bambou à l’autre pour constituer la résistance des poutres du toit. Ce ne sera pas l’esthétique lisse de la boite industrialisée et parachutée ni celle de l’assemblage hétéroclite et désespéré de matériaux récupérés, mais celle de la danse collective qui forme au rythme des pieds la terre du plancher ou celle du souvenir commun de ce même geste précis effectué par tous, assis au sol pour découper les lanières.
Rassembler autour de l’édification c’est donner à chacun une place qui n’est pas réduite à l’effort financier mais une identité revisitée faite de l’accumulation de petits gestes. Parce que pour certaines populations l’architecture en dur ne fait pas partie de leur culture, ici, ils savent désormais que toute partie devant être reconstruite les matériaux seront toujours là, les gestes ne seront pas perdus mais vont se transmettre à d’autres villages. Pourquoi relier ces populations à ces Architectes ? Parce leur stratégie ré-interprète les techniques constructives traditionnelles et réinvente une esthétique contemporaine. Elle devient une forme identitaire, peut-être la propriété de chacun. Ces savoir-faire génèrent ainsi une nouvelle économie locale indépendante et ouvrent différentes voies pour d’autres pays y compris ceux des architectes.
Parce que le problème est la solution. Utiliser les ressources locales c’est, par exemple, revisiter cette graminée géante (qui pousse et re-pousse si vite, juste là, sous des climats allant de + 50° à -5° sans pourrir comme le bois et résistante plus que l’acier 40 kg du mm2 contre 37). C’est décliner toutes ses transformations possibles depuis la tige structurelle jusqu’aux filaments pour la ligaturer sans oublier les bandes pour le tissage. Cette plante surprenante semble pouvoir s’incarner dans chaque élément porteur de la construction : poteau ou poutre, elle résiste indifféremment à tous les types d’efforts compression, tension et flambement. Mais pour Anna Heringer, uniquement reliés ensemble, les bambous forment un assemblage répétitif qui parait fragile avec plus de vide que de matière. Ces intervalles sont là pour recevoir et enserrer d’autres tiges, ils sont peut-être l’absence du détail architectonique attendu : l’esthétique d’une disparition de l’articulation et le dispositif qui permet d’encaisser les courbes indésirables des tiges.
Si formé de cette terre millénaire et de paille, le mur, massif, dense, semble être la puissante protection nécessaire aux enfants de l’école il contraste avec la légèreté des bambous simplement noués qui constituent sa toiture protectrice, peuplée d’écoliers.
VIVRE EN INTERFACE AVEC LE CLIMAX, HABITER LE MUR
Parce que c’est là que tout se passe, que tout est intéressant, que tout peut se produire .
La graminée peut aussi devenir interface, paroi, filtre, natte, clôture, écran, ombrière jouant sur les vides et les pleins : ce n’est pas la beauté des volumes jouant avec l’ombre et la lumière mais celle de l’instant du passage du soleil et les motifs crées à l’intérieur. Anna Héringer sait créer ces moments pour donner à habiter l’espace défini par un dialogue renouvelé avec les éléments climatiques. Ces interfaces sont devenues un lieu de jeux pour les enfants, d’étude pour les apprentis électriciens, ou encore de repos pour les habitants.
Cette esthétique de la transformation immédiate de la matière première se retrouve aussi dans les parois de l’orphelinat de TYIN qui juxtapose les possibilités de mise en œuvre du bambou multipliant ainsi les relations entre l’abri et son environnement tumultueux. Laisser passer le regard pour surveiller les autres enfants du groupe, chuchoter d’une unité à l’autre, se donner un objet, ressentir l’air sur sa peau, glisser sa jeune main dans le tube pour saisir celle de l’autre : autant de limites habitées. Être en interface avec les éléments c’est s’asseoir où l’air soulève les tissus mais aussi dans la fraiche épaisseur du mur, et regarder au loin les rizières depuis le balcon de bambous accrochés au mur juste sous le auvent.
Quand la stratégie du soutenable est – bien au delà de « l’exercice architectural séduisant » – un véritable enjeux, la maîtrise de l’esthétique est l’échelle d’évaluation de la réponse apportée. L’opposition entre la masse de la terre et la légèreté des bambous, la sensualité formelle de la matière, le cadre blanc des fenêtres carrées juxtaposé à l’ombre des percements ronds pour la ventilation, l’attention portée aux grilles de bambous accrochées au façades pour les protéger de la pluie, la matière des plafonds qui entre en résonance avec celle du sol, les couleurs des tissus suspendus associées à celles des tenues traditionnelles des femmes, la teinte rouge des liens, le rythme d’assemblage des tiges, le mouvement des balançoires, l’odeur des nattes tressées, tout rappelle la fragilité, la grâce et l’énergie de ce lampion en papier de riz allumé dans la nuit.